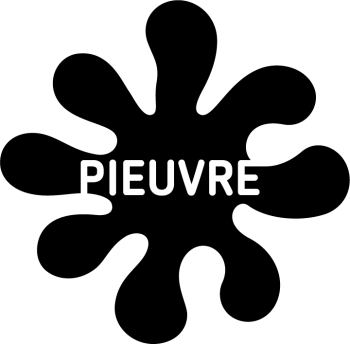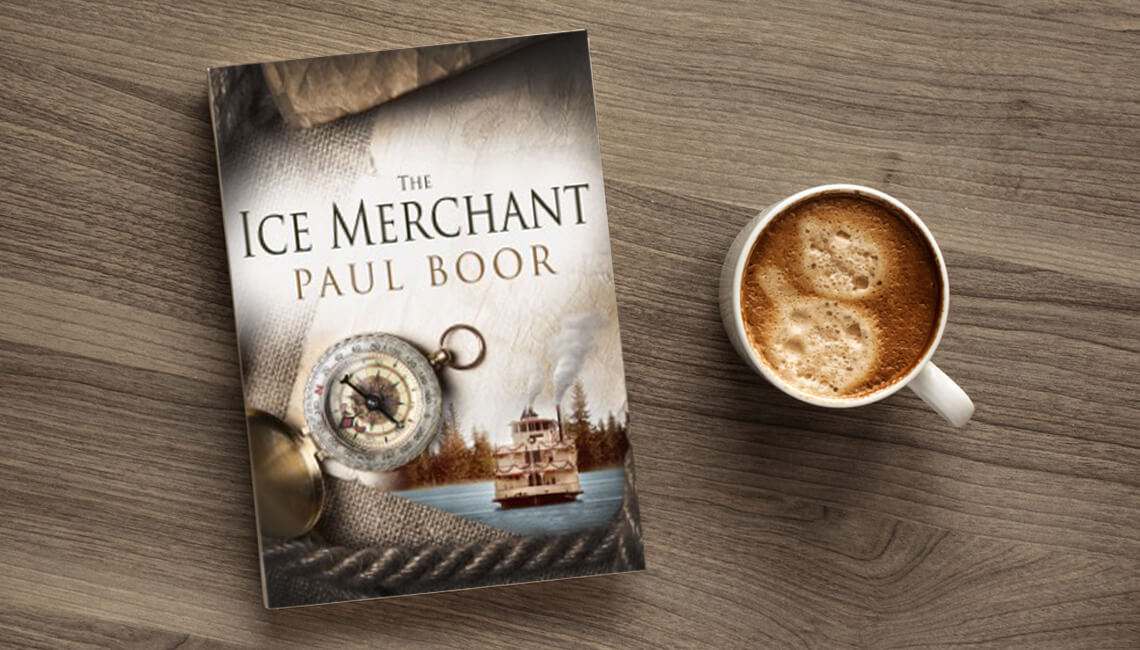L’auteur américain Paul Moor, scientifique et professeur de médecine de formation, a décidé de s’intéresser à l’époque trouble où des cadavres destinés à la dissection et à la production de vaccins étaient transportés illégalement aux États-Unis, avec les risques que cela comportait. Le résultat, un roman intitulé The Ice Merchant, peine toutefois à trouver son erre d’aller.
Nicolas Van Horne est un marchand prospère. Établi dans le nord de l’État de New York, l’homme vend de la glace. Nous sommes au 19e siècle, après tout, et le réfrigérateur électrique, tout comme la climatisation, ne feront leur apparition que de nombreuses décennies plus tard.
Mais Van Horne profite aussi de son transport de glace pour vendre des corps à divers instituts médicaux, y compris à Galveston, au Texas, où il fait la rencontre de la séduisante Renée Keiller, qui planche sur un remède contre la fièvre jaune, une maladie qui faisait alors de terribles ravages à chaque année.
Peu à peu, notre personnage principal se rend compte que sa sinistre cargaison compte des corps d’enfants, enfants qui ont été tués à la tâche dans des postes tenant davantage de l’esclavage que du véritable emploi correctement payé.
Mais alors que Van Horne tente de faire la lumière sur ce sinistre trafic, il tombe peu à peu dans l’enfer de la drogue, il tombe en amour avec Mme Keiller, sa femme se meurt lentement du cancer des ovaires, son fils le renie… Bref, tout serait réuni pour que l’oeuvre de Paul Moor offre aux lecteurs un thriller haletant et palpitant, où l’on s’attacherait rapidement au personnage principal et où l’on souhaiterait que celui-ci réussisse à surmonter ses difficultés.
Malheureusement, M. Moor semble avoir adopté le style d’écriture des auteurs du 19e siècle, justement. Le rythme y est lent, très lent, trop lent. On y suit, dans une succession de chapitres trop brefs pour permettre un véritable développement de l’intrigue, ce qui ressemble bien à toutes les étapes du scénario. En fait, le rythme est si lent, qu’il faut attendre environ la moitié du livre pour qu’il s’y passe quelque chose d’intriguant ou même d’entraînant.
Les problèmes sont aussi nombreux du côté du style d’écriture; qu’il s’agisse ou non d’un hommage aux auteurs d’autrefois, l’idée de concevoir des personnages féminins unidimensionnels est franchement décevante et ennuyante. Passe encore pour l’épouse déprimée et au corps malade, mais lorsque l’on écrit, en toute fin de livre, que Renée Keiller, pourtant une chercheuse dévouée corps et âme à trouver un remède pour une maladie mortelle, se met à « maudire son serment qui fait en sorte que tous les hommes sont égaux », puisque Van Horne « n’est l’égal d’aucun homme », on a franchement envie de lancer le livre à l’autre bout de la pièce.
La chose est d’autant plus frustrante que le terreau était fertile pour écrire un roman palpitant, situé suffisamment loin dans le temps pour donner libre cours à notre imagination. Travail forcé, transport dangereux, régions encore un peu sauvages, maladies mortelles… Tant de potentiel gaspillé dans un roman ennuyeux et monotone. Et que dire de cette apparition du surnaturel en toute fin de livre? Ou de cette dépendance à la drogue qui prend subitement fin alors que notre héros se lève d’un bon matin et lance sa seringue dans une rivière?
À la fois trop long et trop court, The Ice Merchant ne peux définitivement pas bénéficier d’une recommandation.
En complément: