La beauté de Moonlight, qui fait un tabac présentement aux États-Unis, est indéniable. Même si sa portée est un peut-être un brin moins éloquente que sa rumeur l’annonçait, on lui pardonne beaucoup puisque sa sincérité est aussi élégante que son impressionnante maîtrise cinématographique.
Trois parties. Un seul personnage. Trois performances dévouées.
Moonlight nous raconte l’évolution incertaine d’un jeune homme afro-américain en pleine quête identitaire, ne trouvant pied d’ancrage ni dans sa propre personne ni dans son propre milieu.
C’est simpliste en prémisse, mais complexe en exécution, tout en étant formellement éthéré et toujours lumineux, même dans ses séquences nocturnes. La poésie y est constante et les compositions délicates de Nicholas Britell aident beaucoup.
Bien sûr, la première partie est la plus réussie, renouvelant des situations qu’on a pourtant déjà vues, et reposant grandement sur la justesse de ses interprétations, notamment sur la retenue impeccable du jeune Alex Hibbert. Sa complicité inattendue avec Mahershala Ali, qui deviendra rapidement une sorte de mentor, sera pleine de naturel et se montrera des plus attachantes.
Toutefois, bien que limitées, c’est les présences tantôt réconfortante de la chanteuse Janelle Monae et tantôt plus corsée de la toujours brillante Naomie Harris, qui viendront stabiliser le film et faire tournoyer les différents segments. Si on aurait pris davantage de leurs personnages, plus complexes et plus fascinants que l’avancée plus conventionnelle de notre protagoniste néanmoins interprété avec une belle justesse par les successeurs Ashton Sanders et Trevante Rhodes, il y a certainement moyen de se reconnaître dans le tourbillon d’incertitude qui plane au-dessus du personnage, son quotidien mouvant, mais souvent similaire, miroitant plus que jamais celui des États-Unis actuels qui stagnent entre le changement et faire perdurer les erreurs d’hier.
Certes, le second segment axé sur l’intimidation en est un qu’on a vu régulièrement, mais en termes d’ensemble, Moonlight est le remède idéal pour faire avaler la pilule qu’était le faussement choquant 1 : 54 de Yan England. Plus cinématographique que la majorité des longs-métrages qui prennent l’affiche en salles, profitant des possibilités des images, du son et de la juxtaposition des deux tout comme de l’utilisation judicieuse du silence et de la précision d’une mise en scène calculée, pour un premier long-métrage, Barry Jenkins montre le début d’une carrière flamboyante qu’on surveillera de très près.
Mieux, sa façon de démontrer avec espoir la fuite vers l’acceptation et les meilleurs horizons du futur, en font un film qui, malgré son troisième tiers qui s’entiche peut-être un peu trop d’une romance un brin trop facile, arrive à merveille à montrer la dualité entre le changement et les fondements mêmes de notre personnalité qui garde en son centre sa propre base tout en accumulant les influences autant positives que négatives de son propre vécu. C’est ce qui est bien avec ce coming-of-age aux accents conventionnels, c’est que son importance va au-delà et qu’il cherche d’une certaine façon à faire avancer sa nation, à la pousser à atteindre sa propre maturé, ce, en dictant subtilement à son public comment éclore, s’avérant un film essentiel pour tous, principalement les Américains, qui gagneraient beaucoup à s’envelopper des messages du long-métrage.
Ainsi, en prenant son temps, Moonlight arrive doucement, mais sûrement, à faire comprendre son point, à forger sa réflexion du monde moderne et à nous ouvrir les yeux sur tous les possibles du 21e siècle dans toute son ouverture, ses imperfections, mais aussi sa profonde liberté. Voilà donc un premier film réussi, en grande paix avec ses failles, mais également d’une grande fierté envers ses plus jolies réussites.
7/10
Moonlight prend l’affiche en salles ce vendredi 11 novembre.
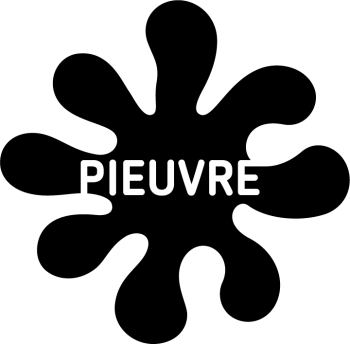






Un commentaire
Pingback: Une leçon d’humilité pour Hollywood à voir en DVD