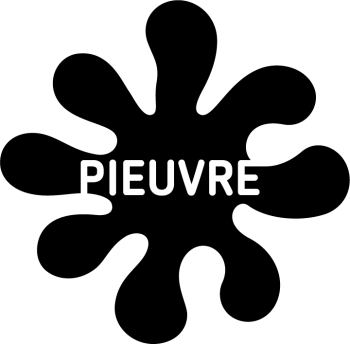Chloé Ouellet-Payeur
Comment recréer une œuvre chorégraphique provenant d’une autre époque? C’est la question qui a été posée à quelques spécialistes lors de la table ronde intitulée La reconstruction en danse, le 14 septembre dernier au Musée d’art contemporain de Montréal.
La réponse à cette question peut sembler évidente à première vue: il suffirait de visionner une captation vidéo de l’œuvre, puis de laisser les danseurs reproduire les gestes qu’ils y voient, dans un espace similaire à celui qui est présenté dans la vidéo. Et voilà. Cependant, pour beaucoup d’artistes en danse, cette question est, au contraire, extrêmement complexe. Elle est paradoxale, voire irrésolvable. Elle l’est entre autres pour Françoise Sullivan, chorégraphe et artiste visuelle, invitée d’honneur lors de cette table ronde. Signataire du Refus Global de 1948, manifeste dont la sortie fut un moment charnière de l’histoire de l’art au Québec, elle est considérée comme l’une des pionnières de la danse moderne québécoise. Parmi les autres invités de la table ronde, on retrouvait le vidéaste Mario Côté, l’historienne de l’art contemporain Anne Bénichou, la chercheure informatique Brigitte Kerhervé, ainsi que l’artiste Armando Menicacci qui agissait à titre de modérateur. Parmi les auditeurs, j’ai remarqué peu de gens de ma génération. J’ai surtout reconnu des chorégraphes ayant déjà une longue carrière derrière eux, ayant vu passer plusieurs époques. Ils écoutaient activement, prenaient des notes, probablement dans un désir de recherche au niveau de la manière de laisser leurs traces aux générations futures.
Lors de cette table ronde, on se devait de parler de La danse et l’espoir, texte de Françoise Sullivan inclus dans le Refus Global. Âgée d’à peine vingt-deux ans à l’époque, elle écrivait avec une sagesse impressionnante et proposait un portrait assez juste des débuts de la danse moderne québécoise. Elle y présentait la danse comme une pratique expressive tirant son essence d’une nécessité vitale. Le texte montrait, comme l’a dit Anne Bénichou, « une vision dionysiaque de l’histoire de la danse ».
La table ronde s’est basée sur une expérience de reconstitution d’une œuvre chorégraphique de Françoise Sullivan, Danse dans la neige, filmée par Jean-Paul Riopelle en 1948, année de sortie du Refus Global. C’est donc dans ce même contexte, selon cette même vision dépeinte dans La danse et l’espoir que Danse dans la neige est née. De cette œuvre, il ne reste comme documentation que des photographies prises par Maurice Perron. Avec l’aide du vidéaste Mario Côté, Françoise Sullivan a tenté en 2007 de reconstituer l’œuvre avec la danseuse Ginette Boutin. Après le visionnement de cette recréation au MAC, Françoise Sullivan a mentionné à plusieurs reprises que sa Danse dans la neige était une improvisation spontanée, contrairement à la vidéo de 2007, qui montrait une chorégraphie préparée. Elle a insisté sur le caractère spontané de la version originale, dont la fébrilité alors palpable n’a hélas pas pu être ramenée dans la reconstitution.
Quels aspects d’une œuvre chorégraphique doit-on garder lorsqu’on veut la reconstituer? Sans trouver de réponse à cette question paradoxale, les invitées Anne Bénichou et Brigitte Kerhervé nous ont proposé des pistes de recherche. Spécialisée dans la conservation des arts visuels, plus spécifiquement de la performance, Anne Bénichou a parlé de l’importance de tenir compte de différents types documents reliés à l’œuvre originale. Elle a d’ailleurs parlé d’un type de source qui m’a particulièrement intéressée: le travail d’artistes contemporains utilisant des références à l’œuvre dont il est question. L’artiste contemporain Luis Jacob, par exemple, a réinterprété Danse dans la neige pour son œuvre A Dance for Those of Us Whose Heart Has Turned to Ice. Comprendre ce à quoi voulait référer l’artiste en utilisant Danse dans la neige a permis à Anne Bénichou de dégager plusieurs enjeux présents dans cette œuvre.
La dernière invitée, Brigitte Kerhervé, nous a parlé du projet ARC_DANSE, un projet très intéressant qui vise à créer une mémoire vivante et créatrice de la danse.
Lors de la période de questions finale, Françoise Sullivan n’a pas su répondre à une auditrice qui lui demandait quels aspects elle avait voulu conserver de Danse dans la neige pour sa reconstitution en 2007. On a compris qu’à son grand désarroi, le sens même de l’œuvre originale n’avait pas pu être conservé lors de sa recréation.
La danse semble être la discipline artistique la plus difficile à documenter, puisqu’il n’existe pas vraiment un langage universel de notation de la danse. La dramaturgie de l’œuvre s’inscrivant dans le corps des danseurs, sa transmission est très difficile. La vidéo ne nous a permis de documenter que les œuvres des XXe et XXIe siècles. De plus, la danse étant un art de l’instant, sa magie provient entre autres de son caractère expérientiel et éphémère. Les problématiques de recréation de la danse sont donc complexes: sa conservation, sa documentation et sa transmission demeurent des enjeux importants.