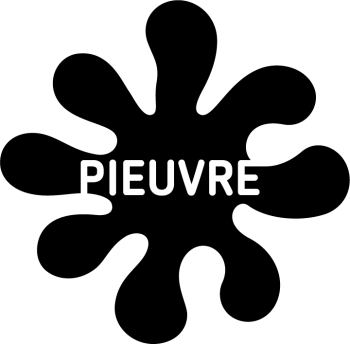De la librairie… à la bibliothèque. Les criminels changent de lieu pour leurs néfastes activités, mais le résultat est le même: des pages se retrouvent ensanglantées, et des havres de paix destinés aux lecteurs sont profanés dans Crimes à la bibliothèque, un recueil de nouvelles paru aux éditions Druide.
Donnant suite aux Crimes à la librairie, paru au début de l’an dernier, ce nouvel ouvrage regroupe, comme son nom l’indique, des textes où l’acte criminel se déroule dans des endroits où ce qui s’y passe de plus excitant est normalement un livre qui tombe des rayons. On a plutôt droit au meurtre classique, mais aussi à des tueurs à gages, des voyages dans le temps, des uchronies, des enquêtes policières teintés de satanisme… Bref, de tout pour tous les goûts, semble-t-il.
Le hic, avec le fait d’imposer à la fois une contrainte de longueur – il s’agit d’une nouvelle, après tout – et un thème précis (la bibliothèque), est que les auteurs sont parfois contraints à une certaine gymnastique littéraire pour respecter les exigences de l’éditeur. Cela peut donner d’excellents résultats, comme cela peut donner un travail bâclé ou simplement ennuyant.
Tous les goûts sont dans la nature, dira-t-on, mais, étrangement, tous les bons passages de Crimes à la bibliothèque semblent avoir été rassemblés au milieu de l’ouvrage. Un peu ridicule de se taper 100 pages de récits tout à fait ordinaires pour enfin tomber sur quelque chose qui attire l’attention. C’est ainsi Anna Raymonde Gazaille, avec Guerrière, qui ouvre le bal de ces textes accrocheurs. On y suit le parcours d’une jeune fille devenue enfant soldat, puis elle-même combattante de la « liberté » au sein d’un groupe intégriste.
Voilà peut-être, en fait, l’explication de l’intérêt du lecteur envers ces textes différents: la bibliothèque, au lieu d’être traitée comme le lieu obligatoire où devra se dérouler la majeure partie de l’action, n’est en fait qu’un emplacement parmi tant d’autres. Libéré de son carcan géographique, l’auteur (ou l’auteure) dispose d’une liberté créative bien plus considérable, et ne se gênera certainement pas pour l’exploiter. La structure narrative est similaire dans Veni Satanas, d’Hervé Gagnon, où l’on enquête sur un crime commis dans une bibliothèque, certes, mais la bibliothèque en question est installée chez les sulpiciens, dans le centre-ville d’une ville de Montréal du début du 20e siècle, et on a droit à une visite de l’Enfer, l’endroit où l’on conserve les livres à l’index. D’ailleurs, il est franchement dommage que M. Gagnon n’ait pas pu développer davantage son idée. Un roman complet consacré à cette histoire serait certainement un succès.
Crimes à la bibliothèque est donc un recueil avec ses hauts et ses bas, ses bons coups et ses textes ennuyants ou tarabiscotés comme la toute première nouvelle, Combustion lente. François Lévesque y aborde la question des massacres dans les écoles et du harcèlement menant à la violence, mais pousse le concept si loin que cela en devient presque drôle. Ou encore cette histoire de bibliothèque « fantôme » figée dans le temps où les gens ne rapportant par leurs livres à temps sont eux aussi transformés en ouvrages? L’idée maîtresse n’est jamais correctement expliquée, et son niveau de complexité est trop important pour qu’on passe simplement outre. Bref, un recueil auquel on voudra peut-être jeter un coup d’oeil, ou à la limite emprunter, sans toutefois l’ajouter à sa collection personnelle.