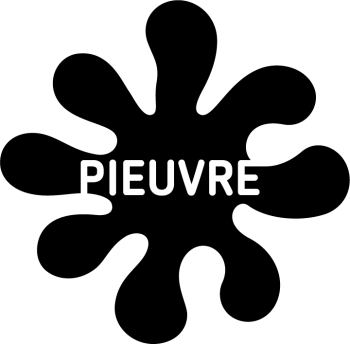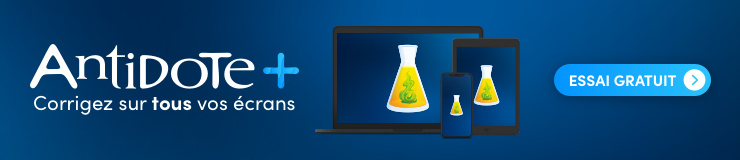Coup sur coup ce mois-ci, sont apparus dans le monde francophone deux manifestes sur la crise climatique rédigés par des journalistes. Ils ont en commun qu’au-delà d’une reconnaissance de la crise, il est devenu nécessaire d’en faire une priorité dans la couverture médiatique.
Une source d’inspiration pourrait être le consortium Covering Climate Now, créé en 2019 : ce groupe, qui rassemble aujourd’hui plus de 460 médias (dont l’Agence Science-Presse) dans 57 pays, propose des pistes pour des sujets, organise des activités virtuelles et facilite le partage de certains reportages entre les différents membres. Le prestigieux quotidien britannique The Guardian, de même que les agences de presse internationales Reuters et l’Agence France-Presse, sont parmi ses partenaires les plus visibles.
Publiée à la fin-août, la « Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique » avait été signée, en date du 16 septembre, par une cinquantaine de médias, quelques associations dont le Syndicat national des journalistes, et six écoles de journalisme de France. L’idée avait été lancée en mars par le média spécialisé Vert.eco.
Le second document provient de Radio France: au début de septembre, la radio publique diffusait son manifeste, intitulé Le Tournant.
Dans les deux cas, ces documents invitent à une couverture accrue, et qui ne soit pas seulement axée sur « l’écologie », comme le dit la Charte. « L’écologie ne doit plus être cantonnée à une simple rubrique; elle doit devenir un prisme au travers duquel considérer l’ensemble des sujets ». « Les antennes de Radio France font de la crise climatique un axe éditorial majeur », lit-on dans le manifeste.
Mettre les solutions de l’avant
Tous les deux insistent également sur du journalisme de solutions, sans le nommer ainsi : «Nous contribuerons à faire connaître les innovations et les solutions, des comportements individuels les plus quotidiens aux changements économiques les plus structurants », insiste Radio France. Et sur de la formation à offrir à leurs journalistes. « Nous changeons de philosophie : l’environnement et la science ne seront pas l’affaire des seuls journalistes spécialisés, ils constitueront le socle de connaissances indispensables mobilisables par toutes nos équipes éditoriales. »
Ces deux documents apparaissent également en France dans la foulée d’un été qui a battu de nouveaux records de chaleur (trois canicules, dont une précoce en juin), en plus d’une sécheresse elle aussi historique. Pour une des initiatrices de la Charte, Sophie Roland, « Les médias se sont davantage interrogés sur le lien entre ces événements et le changement climatique ».
Il a fallu en effet du temps, reprochent plusieurs des intervenants français, pour que se développe le réflexe d’arrimer le contexte climatique à la couverture au quotidien des événements météorologiques extrêmes. Et c’est encore loin d’être devenu une habitude. C’est d’ailleurs une des doléances fréquentes du directeur de Covering Climate Now, le journaliste américain Mark Hertsgaard. « Cette sorte de journalisme laisse le public non informé, mais surtout mal informé », écrivait-il l’an dernier dans The Guardian. « Cela donne l’impression que ces tempêtes et ces incendies, bien que dramatiques, sont simplement des désastres « naturels ». »
Et c’est sans compter ceux qui, dans certaines rédactions, continuent de croire que le réchauffement climatique est un « débat » contradictoire au même titre qu’un débat politique où deux positions de valeur égale s’affrontent. Là-dessus toutefois, certains médias, comme le Guardian, Le Monde ou la BBC, ou certaines émissions comme Les Années lumières à Radio-Canada, ont clairement décidé, il y a déjà plusieurs années, qu’il n’y avait plus lieu d’inviter un climatosceptique chaque fois qu’on parlait de climat.
Une meilleure compréhension de ce qu’est la science du climat —et de la différence avec un débat politique— a fait son chemin au fil des années, reconnaissent autant les initiateurs de la Charte que ceux du manifeste. Dans un reportage publié là-dessus cette semaine par Vert.eco, le directeur de l’information de Radio France juge même que la COVID a joué un rôle d’accélérateur: la pandémie « a injecté de la science dans nos rédactions, un appétit, une nécessité et mis le doigt sur nos faiblesses. » Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les deux documents mentionnent l’importance de la formation pour leurs journalistes.