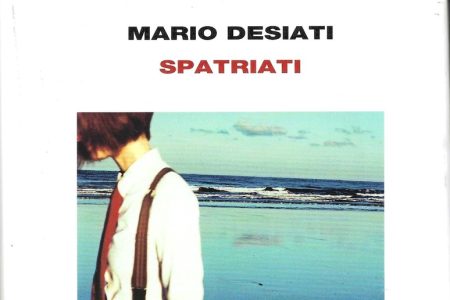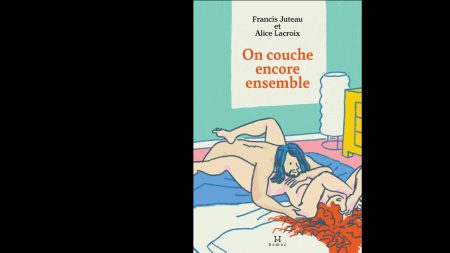Il n’y pas de fin heureuse, dans Rodéo. Le roman d’Aïko Solovkine, d’abord écrit en Belgique, en 2016, puis publié cette année au Québec, du côté de chez Quai no 5, raconte clairement et directement les travers de la vie de banlieue, de l’existence dans les zones laissées de côté par la mondialisation. Et les bons côtés, là-dedans? Quels bons côtés?
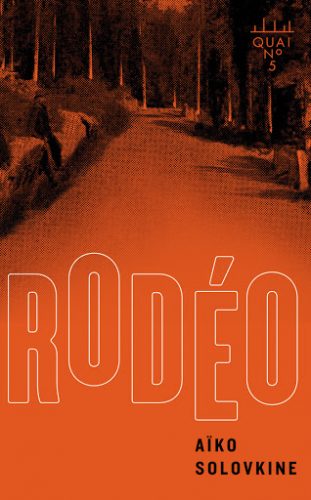
Existences misérables, éducation minimale, peu, sinon aucune perspective d’avenir, si ce n’est d’occuper les mêmes emplois, de contribuer aux mêmes dettes et de mourir d’ennui de la même façon que leurs parents, coincés dans des pavillons peu entretenus remplis d’objets de consommation destinés à remplir le vide existentiel qui menace de tout faire s’écrouler.
Et dans la ville qui nous préoccupe, quelque part dans l’ancien coeur industriel du nord de la France, où traînent encore des pistes et des hangars datant de l’occupation allemande, la jeunesse fait comme elle fait partout ailleurs dans le monde: elle boit, prend de la drogue, rêve secrètement d’amour, mais s’en tient à la baise, quand ce n’est pas à l’agression sexuelle ou au viol pur et simple.
De fait, l’ouvrage n’a beau faire qu’environ 160 pages, il fait probablement plus mal qu’une brique bien plus longue. Pourquoi, au fait? Peut-être parce qu’on s’attend constamment à un revirement de situation, à une amélioration des perspectives d’avenir des protagonistes, à un peu de lumière dans cet océan de grisaille. Fallait-il vraiment, après tout, profiter de la pandémie et de l’accélération des canicules, symbole clair de la détérioration du climat, pour lire un roman où la mort semble pratiquement plus intéressante que de poursuivre une existence sans but?
Eh bien, détrompez-vous: à l’instar de Requiem For A Dream, qui tape si fort sur le clou que ce dernier en vient pratiquement à complètement traverser la planche où il se trouve, en quelque sorte, Rodéo refuse obstinément de prendre le lecteur par la main, et étale plutôt l’horrible « beigitude » crasse de la vie plus qu’ordinaire. Une vie, d’ailleurs, où ceux qui souhaitent s’en sortir font l’objet de moqueries, voire de vilains tours du hasard. La médiocrité alimente la médiocrité.
On dépose le livre après avoir résisté à l’envie de le lancer par la fenêtre; non pas parce qu’il est mauvais, mais parce qu’il vise trop dans le mille, parce qu’on pourra toujours blâmer le capitalisme sauvage, la flambée des prix de l’immobilier, l’étalement urbain, le populisme des gouvernements, ou encore la téléréalité, force est d’admettre qu’il est impossible de ne pas penser, pendant un instant, qu’il faut parfois vouloir être sauvé pour mériter de l’être.
Rodéo, d’Aïko Solovkine, publié chez Quai no 5, 156 pages.