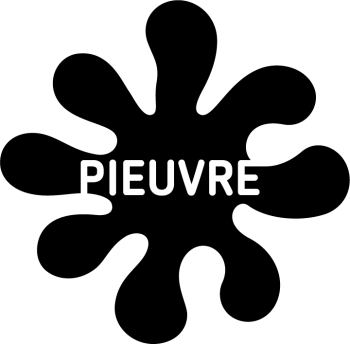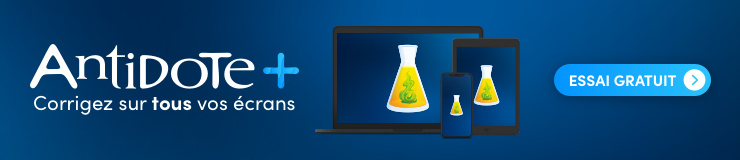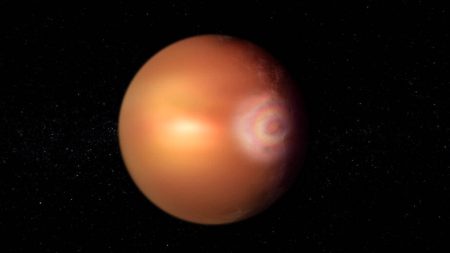Réduction des déplacements pour le travail, réduction des collaborations et des conférences scientifiques… Il faut s’attendre à ce que le monde de la recherche ne soit pas le même après le retour à « la normale ».
Le monde de la recherche risque en effet de rétrécir, avance la revue Nature dans un reportage récent, sixième d’une série sur « la science après la pandémie ».
Par exemple, sur les 50 visites de chercheurs prévues au Sydney Mathematical Research Institute de l’Université de Sydney, 30 ont été reportées ou annulées en raison de la Covid-19.
À travers le monde, certains chercheurs craignent que ces limitations ne conduisent à favoriser les scientifiques d’élite et les équipes établies, celles qui ont moins besoin de ce type de réseautage. D’autres ont peur de perdre des collaborateurs et de se retrouver marginalisés. En plus de la possibilité que le travail de terrain ne devienne un luxe.
À l’inverse, les restrictions de voyages pourraient aider à démocratiser certains secteurs, si le travail virtuel permet de multiplier les connexions pour les personnes qui ne pouvaient pas facilement voyager. Mais dans tous les cas, de nombreux chercheurs devront repenser leurs projets.
La chercheuse en sciences et en politiques à l’Université d’État de l’Ohio, Caroline Wagner, a comparé des publications sur le coronavirus en 2018 et 2019 avec des articles évalués par des pairs et des prépublications entre janvier et avril 2020. Elle conclut que, depuis l’éclosion, les équipes de recherche — mesurées par le nombre d’auteurs — sont devenues un peu plus petites et impliquent moins de pays. Les liens de co-auteurs entre la Chine et les États-Unis ou d’autres pays riches se sont renforcés, tandis que la participation des pays en développement a diminué. Ce qui suggère que les chercheurs travaillent avec ceux avec qui ils ont déjà des connexions.
La collaboration internationale risque donc de ralentir, particulièrement chez les chercheurs en début de carrière qui n’ont pas eu l’occasion d’établir ces liens, avance le sociologue Richard Woolley, de l’Université polytechnique de Valence, en Espagne.
Les pays excentrés comme l’Australie sont également plus à risque, en raison de leur main-d’œuvre scientifique très internationale: 35% des 65 000 étudiants australiens à la maîtrise et au doctorat. Un rapport de l’Académie australienne des sciences, publié le 8 mai, évalue que 9000 étudiants étrangers manqueront à l’appel cette année, en raison de contraintes financières ou de restrictions de déplacement.
L’article de Nature donne l’exemple du virologue au Centre Pasteur du Cameroun, Sébastien Kenmoe, qui dirige une étude sur les maladies fébriles en Afrique subsaharienne. Il a dû annuler un voyage et développe plutôt des moyens de surveiller les épidémies à distance.
Mais pour certaines disciplines, il n’y a pas de substituts à la mobilité internationale. Depuis la pandémie, Jonah Choiniere, un paléontologue sud-africain, a dû annuler plusieurs voyages, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sans accès aux fossiles, il compte redoubler d’efforts pour recueillir des données auprès des universités et des musées d’ailleurs, mais les voyages internationaux sont l’épine dorsale de sa recherche.
Bien que la plupart des chercheurs s’attendent à ce que les déplacements sur le terrain finissent tôt ou tard par reprendre, l’impact de la pandémie pourrait affecter leur productivité pour quelques années.
Les avantages: une recherche plus verte?
Reste qu’il peut y avoir des avantages, pour les personnes moins mobiles ou qui n’ont pas les moyens de se déplacer.
Moins de voyages en avion pourrait aussi rendre la recherche plus « verte », répondant ainsi à une critique de longue date, sur l’impact climatique des congrès scientifiques internationaux. « Faire preuve de responsabilité scientifique devrait signifier faire de son mieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ne pas contribuer à la propagation d’une pandémie », relève encore le sociologue Richard Woolley.
Tous les déplacements n’ont pas une valeur égale pour la production de connaissances et le coronavirus pourrait pousser les chercheurs à réfléchir sur la manière de produire la science différemment.
À un pas d’un signal stellaire vieux de 13 milliards d’années