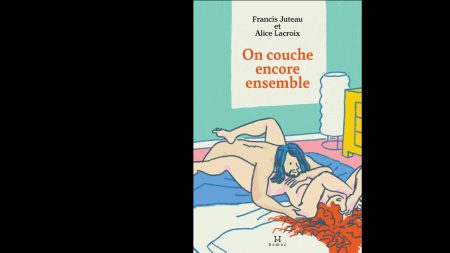Quelque chose semble s’être figé dans le temps, dans la petite ville de Kamakura, au Japon. Autrefois jeune femme rebelle souhaitant fuir l’éducation stricte de sa grand-mère, Hatoko revient dans sa ville natale pour s’occuper de la papeterie familiale, dans l’étrangement beau roman La papeterie Tsubaki, d’Ogawa Ito.
Publié aux Éditions Philippe Picquier, ce récit semble se dérouler hors du temps. Nous sommes à l’époque contemporaine, bien entendu, avec ces mentions de téléphones cellulaires et de courriels – et la version originale du roman fut publiée en 2016, après tout –, mais la papeterie, elle, tout comme la quasi-totalité de cette petite ville de banlieue relativement éloignée de Tokyo, donnent l’impression d’appartenir à une autre ère. Cela tient sans doute au fait qu’en plus de gérer la papeterie, Hatoko est également écrivaine publique.

Métier fort probablement disparu des sociétés occidentales depuis belle lurette, quand ces scripteurs n’ont pas migré vers le domaine de la rédaction, publicitaire ou autre, le travail d’écrivain public est central dans la vie de notre héroïne: appelée à rédiger lettres, missives et autres petits mots au nom des autres, Hatoko vit un peu par procuration – et les lecteurs également, par la même occasion. Avec une plume à la fois légère et complète, Mme Ito (ou est-ce Mme Ogawa?) nous transporte dans un monde fait de minutie et de délicatesse. Chaque lettre rédigée par le personnage principal est mise en contexte, décrite avec un soin fascinant, et, surtout, reproduite en japonais dans la version française du roman, mise en page comprise. L’auteure prendra aussi le temps de décrire l’encre utilisée, le type de papier, l’épaisseur de l’enveloppe, voire le genre de timbre, ou encore quel crayon, stylo ou plume a servi à écrire le tout.
Lors de la toute première occasion où le lecteur est témoin de ce rituel, on se dit que tout cela est un peu superflu. Que les détails peuvent être ignorés, qu’on pourrait passer à la suite du scénario. Paradoxalement, ou peut-être est-ce simplement l’explication logique de cet état de fait, il n’y a peu ou pas de trame scénaristique centrale au roman. Des choses se déroulent, bien sûr, et l’on obtiendra ultimement une conclusion qui risque de satisfaire le lecteur, mais Ogawa Ito a choisi de parier gros: l’auteure a décidé d’aller à contre-courant du style de rédaction classique, et de se concentrer sur les petites choses. Si George Perec avait ses excès de descriptions dans La vie, mode d’emploi, Ogawa Ito, elle, a son écrivaine publique et sa passion pour l’écriture. Non pas une écriture mécanique, banalisée, à l’image de ces lettres qui s’enlignent sur un écran ou sur une feuille de papier glissée dans une dactylo, mais cette écriture vivante, bien réelle, qui naît sur un papier sur lequel on trace amoureusement des caractères.
La papeterie Tsubaki est un étrange roman, qui échappe à toute classification. C’est un roman de l’objet, une oeuvre magnifique quasi-hors du temps. Un livre qui détonne, certes, mais uniquement pour les bonnes raisons.
Dans les annales criminelles du Québec avec L’affaire Delorme