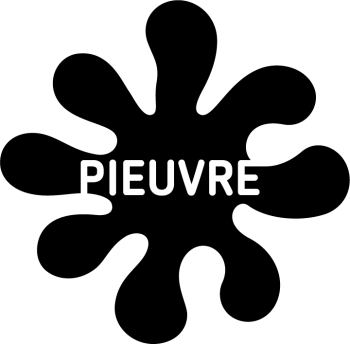La guerre des îles Malouines en 1982 a « aidé » la Chine à récupérer la colonie anglaise de Hong Kong, affirme le chercheur en géopolitique, Manuel Paz dans son essai De Malvinas à Hong Kong.
De la guerre de l’opium en 1842 jusque vers la fin du 20e siècle, la Chine n’a pas réclamé ce territoire au Royaume-Uni. Les négociations pour la restitution du territoire ont commencé en 1982, le 6 avril exactement. À peine quatre jours après la déclaration de la guerre des Malouines.
« Tant les Chinois que les Britanniques ont admis que le premier contact au sujet de Hong Kong s’est fait en 1982. Avant que commence la guerre, l’Argentine a demandé un soutien à la Chine dans le cadre de l’ONU pour le conflit aux Malouines. Les Chinois ne les ont pas appuyés parce qu’ils avaient d’autres intérêts sur le même enjeu. Le 6 avril 1982, ils ont commencé à discuter avec les Britanniques au sujet de Hong Kong », explique l’auteur au quotidien argentin LA NACION du 2 avril.
1982 a été l’année de la guerre des Malouines, mais aussi l’année où les négociations afin que Hong Kong laisse son statut de colonie pour devenir une région administrative spéciale de la République populaire de Chine le 1er juillet 1997.
L’auteur arrive à la conclusion que le conflit belliqueux au large de l’Argentine a été une « excellente affaire » pour la Chine profitant du fait que l’Angleterre soit occupée avec cette situation pour résoudre le problème.
Intouchables d’Occident
« À 85 % , les personnes interrogées ont estimé que les Indiens du Royaume-Uni participaient activement au système des castes », indique une étude de l’organisation de défense des intouchables Dalit Solidarity Network UK en juillet 2006. En Inde ou ailleurs dans le monde, le système des castes maintien les intouchables (dalits), c’est-à-dire un groupe d’artisans du cuir considérés inférieurs à la plus basse caste, lit-on dans le Monde diplomatique de mars.
Au milieu du 20e siècle, 40 000 intouchables de l’Inde ont émigré en Angleterre, à Coventry, pour échapper à cette condition. Si l’hostilité du pays d’accueil les a mis au même niveau que les autres immigrants pendant une dizaine d’années, le regroupement familial a importé la discrimination traditionnelle. « Les femmes très pieuses et moins instruites ont repris en charge la pureté religieuse », explique le chercheur en anthropologie au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Nicolas Jaoul.
Depuis 2010, la question empoisonne le débat politique. Un premier amendement propose d’ajouter les préjugés liés aux castes à la liste des comportements et propos prohibés, et un second, d’enquêter sur le phénomène. Seul ce dernier est voté.
« Le système des castes se reproduit dans les institutions multiculturelles, comme l’école, où des manuels le décrivent encore comme faisant partie de l’hindouisme. Les élus locaux qui jouent un rôle dans le financement des temples peuvent aussi pratiquer un favoritisme de caste », affirme Nicolas Jaoul.