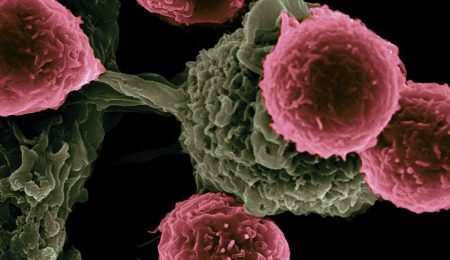Chez les souris, l’approche a permis de stopper la croissance et la propagation d’une tumeur, révèle l’étude publiée en juin dans le journal Science Advances. Le taux de survie des souris traitées avec les microrobots était également plus élevé que celui des souris ayant reçu le traitement conventionnel (37 jours contre 27).
Browsing: algues
« Ce n’est pas une idée nouvelle, mais elle génère un engouement scientifique. Parce que ces végétaux aquatiques croissent par photosynthèse en capturant le CO2 de l’eau, la culture des macroalgues – de grandes algues qui peuvent atteindre plusieurs mètres – permet un stockage rapide du carbone. »
Sur les quelque 10 000 espèces différentes d’algues recensées aujourd’hui dans le monde, à peine 145 sont mangées par les humains, principalement en Asie.
Aussi désagréables qu’elles soient lorsqu’elles s’échouent, ces grandes algues (ou « macroalgues ») constituent un habitat naturel — lorsqu’elles flottent — pour des poissons, des crabes et des tortues marines. C’est lorsqu’elles s’échouent qu’elles commencent à mourir et se décomposent, au grand déplaisir des humains.
Il faut savoir que le lien entre les rats et les récifs de corail passe en partie par les oiseaux qui viennent pondre leurs oeufs sur ce récif, et en partie par les grandes algues environnantes (ou macroalgues).
Au-delà des tracas qu’elle pose aux humains, cette masse organique en décomposition nuit aux autres espèces marines. Elle peut étouffer la mangrove, un écosystème de marais maritimes.
Moins d’oiseaux veut dire moins de crottes dans l’eau. Moins de crottes veut dire moins d’azote et de phosphore dans l’eau. L’azote et le phosphore contribuaient à la croissance des algues autour des récifs de corail.
Depuis quelques années, le Québec, à l’instar de beaucoup d’autres endroits dans le monde, voit une multiplication des « fleurs d’eau » — des cyanobactéries qui transforment des lacs en une « soupe bleue verte ». Impropre à la baignade, à la consommation et même inhospitalière pour une partie de la faune aquatique.
Le long des plages du Saint-Laurent, les algues se multiplient et les odeurs repoussent parfois les promeneurs. Mais l’impact se fait aussi sentir sous la surface. « Imaginez une choucroute indigeste venant bouleverser l’équilibre fragile du milieu », décrit Gwenaëlle Chaillou.
L’intensité des éclosions d’algues durant l’été a augmenté au cours des trois dernières décennies, selon la première étude mondiale portant sur des dizaines de grands lacs d’eau douce, étude qui a été menée par deux chercheurs de l’Université Carnegie et par une scientifique de la NASA, pour le compte de Nature.