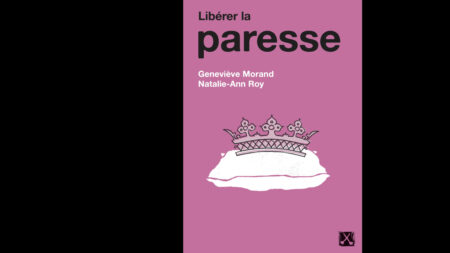Voilà des années que la semaine de quatre jours est présentée comme une solution pour régler, du moins en partie, les maux rattachés au monde du travail. Après tout, comment ne pas aimer un horaire de travail moins chargé, et un salaire qui demeure constant? Pour Julia Posca, toutefois, cette porte de sortie est au mieux une béquille, et au pire l’arbre qui cache la forêt.
Le titre de l’essai publié chez Écosociété est clair: Travailler moins ne suffit pas. Même si les essais de cette semaine de quatre jours de travail semblent concluants, diverses preuves à l’appui, des preuves recueillies dans plusieurs pays, au sein de nombreuses entreprises, ces dernières oeuvrant dans différents domaines.
Mme Posca ne nie pas, d’ailleurs, l’efficacité de cette mesure. Mais l’occasion est trop belle, dans le contexte, pour mettre de l’avant les nombreux autres problèmes qui suscitent un pourrissement du monde du travail. Car, comprend-on en lisant cet essai, la semaine de travail est un peu la version classe moyenne de la hausse du salaire horaire à 15$: pendant des années, des mouvements ont mis de l’avant une amélioration de l’ordinaire du travailleur moyen via une augmentation salariale et une diminution du temps consacré à gagner sa vie.
Mais si les avancées en ce sens ont effectivement permis de favoriser un certain enrichissement du 99%, l’autrice souligne rapidement que les entreprises et les plus riches en ont souvent profité pour accepter ces demandes, sans toutefois s’attaquer carrément aux véritables problèmes qui gangrènent notre société.
De faux progrès
Car non seulement le travail peut-il être abrutissant, avec des tâches superflues, ou encore inutiles, quand elles ne sont pas si répétitives qu’elles en deviennent abrutissantes, ou encore dangereuses pour la santé physique ou mentale, mais le temps gagné au fil des luttes ouvrières a été transformé en autant d’heures où nous sommes plus qu’encouragés à « mettre à profit » ces moments de loisir non pas en pratiquant une activité personnelle, par exemple, mais plutôt en consommant encore et toujours des produits dont la vente remplit les coffres des entreprises.
Pire encore, on nous rabat les oreilles avec l’idée d’une « culture d’entreprise » où il est attendu que les employés répondent aux appels et autres messages reçus en-dehors des heures de bureau, voire durant ses vacances. La « nouvelle » tendance n’est-elle pas le concept des « tracances », ces vacances où l’on travaille, peu importe l’endroit où l’on se trouve, dans le monde?
Les biens de consommation deviennent hors de prix? Plutôt que de réduire les salaires des dirigeants, on encourage plutôt la population à se trouver un deuxième emploi. Ou à s’endetter. Ou pourquoi pas les deux? Et si la pression devient trop forte, alors c’est qu’il faut se prendre une « journée à soi », mais sur son temps libre, histoire de dépenser des sous pour relaxer. La santé mentale, après tout, n’est pas l’affaire de l’entreprise, mais un enjeu individuel. Idem pour les séances de thérapie, bien souvent peu ou pas remboursées par les rares assurances collectives proposées aux travailleurs.
Bref, le monde du travail, destiné à alimenter une machine ultracapitaliste en surchauffe, craque de partout. Et durant le bref laps de temps où, au sortir de la pandémie, les travailleurs ont eu un certain ascendant sur les entreprises, après avoir constaté qu’il existait autre chose qu’une vie consacrée à un éternel labeur, histoire de se payer une maison sans âme dans une ville de banlieue envahie par l’automobile, on a préféré parler de « pénurie de main-d’oeuvre ».
En un peu plus d’une centaine de pages bien tassées, bref, Julia Posca propose une liste non exhaustive des véritables problèmes de notre monde économique. Oui à la semaine de quatre jours, mais 24 heures de plus « à soi » – idéales pour aller faire l’épicerie, tiens, ou passer l’aspirateur – ne sauveront pas la planète capitaliste. Il faudra déconstruire. Et cela va faire mal.
Travailler moins ne suffit pas, de Julia Posca, publié aux éditions Écosociété, 138 pages