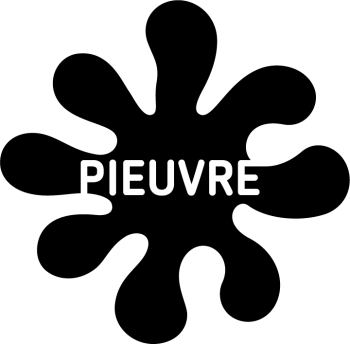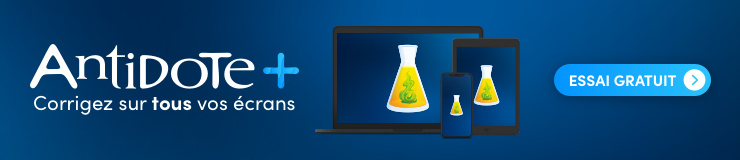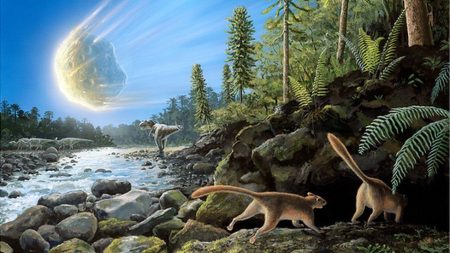Il faut comprendre qu’il ne s’agit pas « l’apparition » de la sexualité. Longtemps auparavant, la détermination du sexe du futur individu était probablement fonction de facteurs environnementaux comme la température — c’est le cas aujourd’hui chez certaines espèces de poissons et de reptiles.
Browsing: génomique
Par essais et erreurs, les experts tentent de découvrir les véritables fonctions de ces gènes ou, à l’inverse, de découvrir quel serait le génome « minimal » qui permettrait encore à un tel organisme de vivre et de se reproduire.
En filigrane, c’est la biologie humaine, bien plus que la biologie des primates, qui intéresse ceux qui vont plonger dans ces génomes, incluant l’étude de nos maladies causées ou aggravées par des mutations encore mal connues.
Certains scientifiques croient qu’on pourrait aussi, grâce à ces données, se projeter dans l’avenir. Un groupe a ainsi tenté d’en tirer un modèle prédictif sur les espèces qui seraient les plus vulnérables à un futur coronavirus.
Il s’agit d’une algue unicellulaire du groupe des cryptomonades, qu’on retrouve un peu partout dans des bassins d’eau douce.
Il existe déjà, depuis 2012, le Projet 1000 Génomes qui était lui aussi fixé sur l’idée de diversité, mais qui avait plus précisément pour but de cataloguer les variants, rares ou non, dans 26 différentes populations.
Ce sont deux disciplines que tout séparait il n’y a pas si longtemps, et que les progrès technologiques sont en train de rapprocher: aux frontières de l’archéologie et de la génétique, voici l’archéogénétique.
Les premiers scientifiques qui ont péniblement reconstitué les génomes d’humains ayant vécu il y a des milliers d’années, auraient eu de la difficulté à croire qu’à peine deux décennies plus tard, on en serait rendu à pouvoir étudier les gènes… des microbiomes de ces mêmes humains.
Une collaboration à l’échelle internationale entre chercheurs, dont des scientifiques de l’Université d’Adélaïde, en Australie, et de l’Université de la Saskatchewan, a permis de découvrir de nouvelles variations génétiques dans les génomes du blé et de l’orge. Cette percée représente une avancée importante pour la mise au point de variétés plus productives de ces deux plantes très largement utilisées par l’industrie agricole mondiale.
Ce n’est plus un secret que le gouvernement chinois a beaucoup investi dans les technologies de reconnaissance faciale —technologies qui, dans une société qui investit également beaucoup dans la surveillance vidéo, peuvent permettre de suivre à la trace une personne. Voilà que l’ADN pourrait théoriquement permettre d’aller encore plus loin.